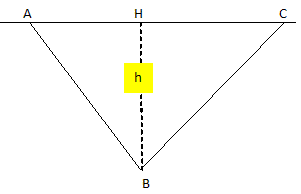Une balle est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h = 2,00 m par rapport au sol.
Cette balle élastique effectue une succession de rebonds verticaux.
L'énergie cinétique de la balle juste après un rebond diminue de 37 % par rapport à son énergie cinétique juste avant ce rebond.
On considère une caméra dont l'objectif est placé dans un plan horizontal situé à une hauteur h'=40,0 cm par rapport au sol.
On néglige l'action de l'air sur la balle.
Question :
Déterminer le nombre de fois où la balle va passer dans le plan de l'objectif de la caméra. 3, 5 ;
7 ;
9 ;11 ;
aucune réponse exacte
Poids apparent.
On dispose d'un ressort de masse négligeable, de constante de raideur k = 5,4 N / m et de longueur à vide L0 = 12 cm. L'extrémité supérieure est fixée à un support horizontal.
On suspend à l'extrémité inférieure de ce ressort une sphère métallique de rayon R = 1,5 cm. La longueur du ressort à l'équilibre est L1 = 17 cm.
On immerge ensuite complètement la sphère dans un liquide de densité d inconnue. La longueur du ressort à l'équilibre est L2 = 15 cm.
Question :
Calculer la densité du liquide.0,62 ;
0,78 ;
0,85 ;0,92 ;
0,98 ;
aucune réponse exacte
Satellite.
Un satelitte de masse m= 530 kg décrit une trajectoire circulaire autour d'une planète de masse M.
Ce satellite se situe à une altitude de h =340 km par rapport à la surface de la planète.
La période de révolution du satellite est T = 1 h 34 min et sa vitesse vaut 7,13 km/s dans le référentiel planètocentrique.
Question :
Parmi les affirmations suivantes, relatives à ce satellite, combien y en a t-il d'exactes ?- Le rayon de la planète vaut R = 6,1 103 km.
- la masse de la planète vaut M = 4,9 1024 kg.
- la densité moyenne de la planète vaut d = 5,2.
- La force gravitationnelle exercée par la planète sur le satelitte a pour valeur F = 4,2 103 N.
- Le satellite est soumis à une accélération normale aN =7,9 m s-2.
Associations de résistors
Question :
Déterminer UBM en volt. 2,0 ;
4,0 ;
6,0 ;
8,0 ;
16,0 ;
aucune réponse exacte
Solénoïde
On considère un solénoïde de longueur L = 60 cm dont l'axe est perpendiculaire à la direction de la composante horizontale BH du champ magnétique terrestre. Une boussole est placée au centre du solénoïde.
Quand on fait circuler un courant d'intensité constante I = 88 mA dans un sens donné, la direction de l'aiguille de la boussole fait un angle aigu a avec l'axe du solénoïde.
En inversant le sens du courant, l'aiguille de la boussole tourne de 151° par rapport à sa position précédente.
Question :
Calculer le nombre de spires N de ce solénoïde. 420 ;
450 ;
500 ;
520 ;
550 ;
aucune réponse exacte
La loupe
Un oeil normal voit tous les objets situés entre l'infini e la distance minimale de vision distincte Dm = 25 cm.
On utilise une loupe assimilée à une lentille mince convergente de vergence C = 6,0 dioptries.
Un observateur place son oeil " normal " au foyer image de la loupe.
Il regarde un objet AB, perpendiculaire à l'axe principal de la loupe, le point A étant situé sur l'axe.
On note L la distance algébrisée entre le centre optique et A.
On notera L1 la valeur que l'on doit donner à L pour que l'image A' de A soit à l'infini.
On notera L2 la valeur que l'on doit donner à L pour que l'image A' de A soit située à la distance minimale de vision distincte.
La latitude de mise au point de la loupe est L2-L1.
Question :
correction fixe
correction chimix
Calculer la latitude de mise au point en cm.
11 ;
14 ;
18 ;
20 ;
22 ;
aucune réponse exacte
correction fixe
correction chimix